EN DIRECT, guerre en Ukraine : le domicile d’Andriy Yermak, chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, visé par une perquisition des services anticorruption

© Martial Trezzini/Keystone via AP

© Martial Trezzini/Keystone via AP

© Chan Long Hei/AP




Elena règle enfin ses comptes avec Victoria et Nate. Découvrez les temps forts du 9361e épisode des Feux de l'amour diffusé à 10h55 le lundi 1er décembre 2025 sur TF1.
Stars à domicile fait son grand retour ce vendredi 28 novembre 2025 sur TF1. La chaîne a dévoilé les nouveautés de cette nouvelle version incarnée par Isabelle Ithurburu.

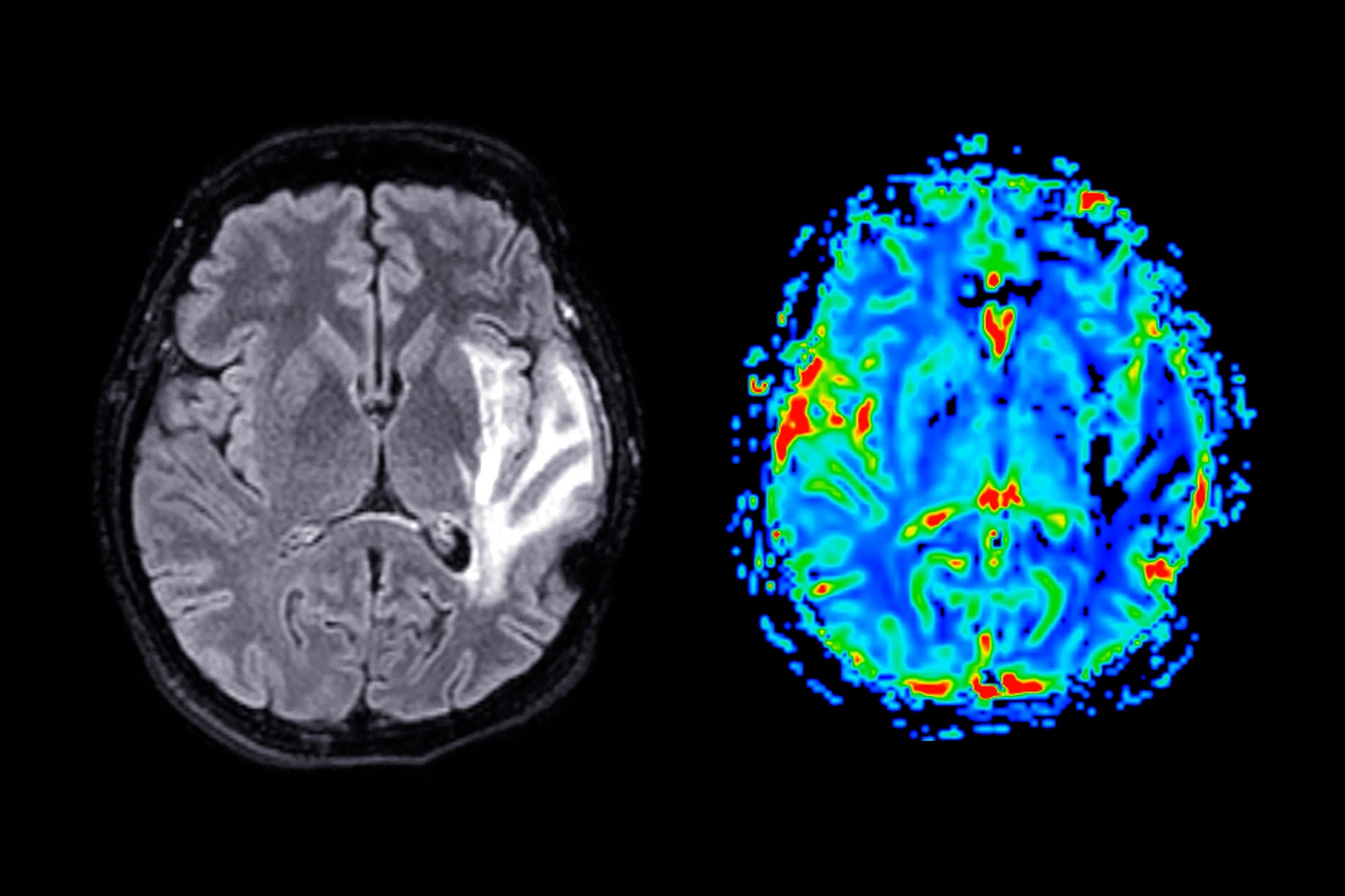
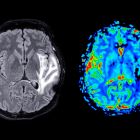


Le commandant de bord vient de signaler que l’avion est sur le point d’atterrir et vous vous dites : c’est le moment d’aller aux toilettes ! Erreur. C’est exactement à ce moment-là qu’il vaut mieux éviter d’aller aux toilettes. À l’inverse, voici le moment idéal.

"Ah ! Ce qu’on sert de faux ré / À ce concert de Fauré" (Lucienne Desnoues). Voilà ce qu’en poésie, l’on nomme des vers holorimes. Avez-vous découvert leur particularité ?

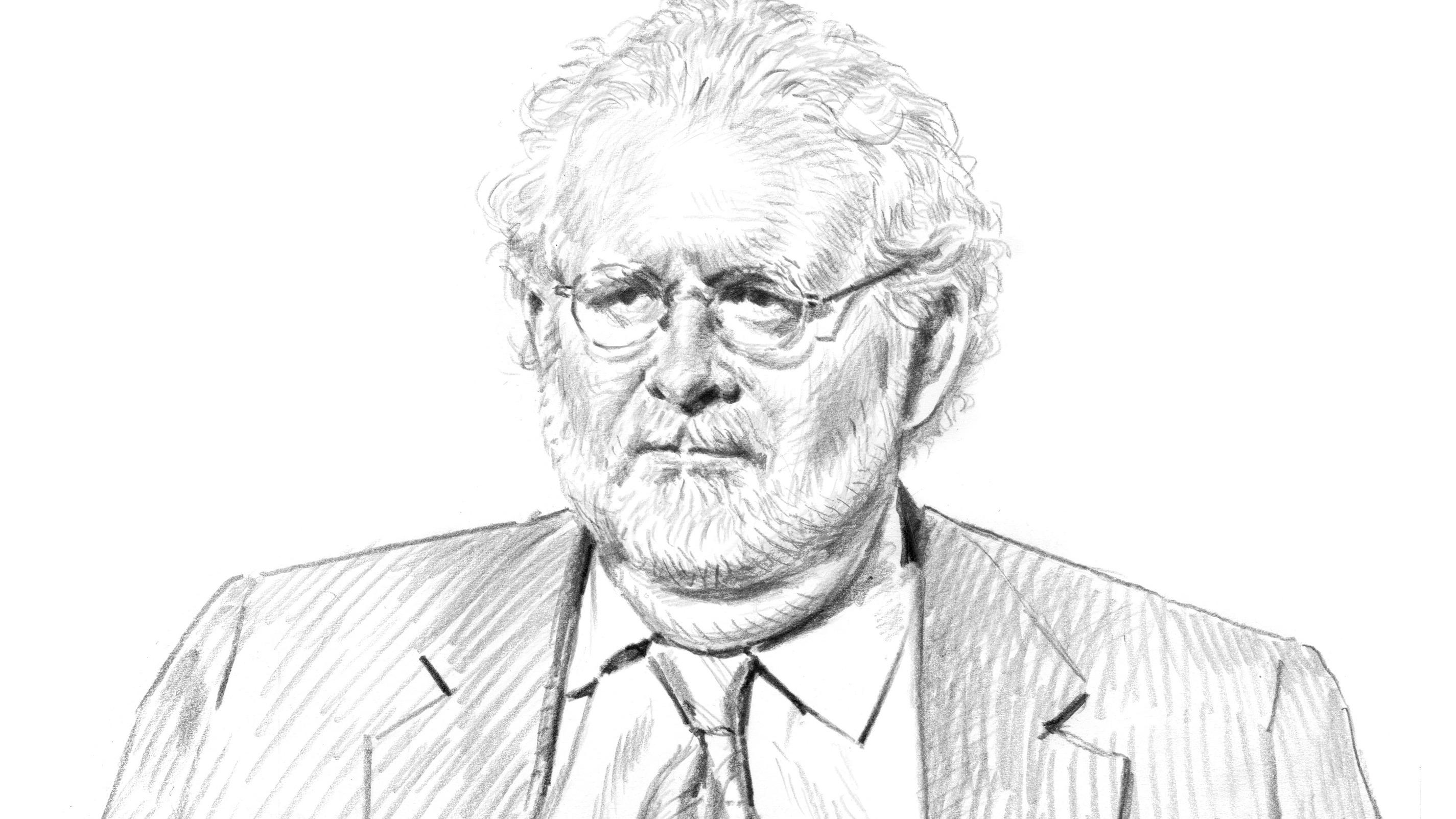
© Fabien Clairefond


© Manuel Orbegozo / REUTERS
De Belém pour parler climat à Johannesburg pour évoquer notamment les dossiers Soudanais et Palestiniens, les Européens étaient très occupés la semaine dernière. On attendait beaucoup de la COP 30 au Brésil et du G20 en Afrique du Sud : deux grandes réunions auxquelles l’administration Trump avait choisi de ne pas participer, laissant la main notamment à l’Europe.
Mais les Américains comptaient bien se faire remarquer. C’est le moment qu’a choisi Donald Trump pour soumettre à Kiev un nouveau plan de paix, négocié dans le plus grand secret avec... la Russie.
Une annonce surprise, dont les propositions étaient surtout à l’avantage de Vladimir Poutine : cession de certains territoires, réduction de l’armée ukrainienne ou encore interdiction d’entrer dans l’Otan. Le G20 s’est alors transformé dans les coulisses en réunion de crise sur l’Ukraine, et les alliés de Kiev se retrouvaient ensuite à Genève pour formuler une réponse.
Les négociations ont repris. Donald Trump assure qu’il ne reste que "quelques points de désaccord" à régler, quand le Kremlin estime que le nouveau plan européen n’est pas constructif. Du côté de l’Ukraine, on joue les équilibristes avec Washington, alors que les frappes se poursuivent sur le pays. Une séquence qui illustre l’effacement de l’Europe face aux Etats-Unis...
RETROUVEZ TOUS LES EPISODES DE LA LOUPE
Écoutez cet épisode et abonnez-vous à La Loupe sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Addict et Amazon Music.
Inscrivez-vous à notre newsletter.
Cet épisode a été écrit et présenté par Charlotte Baris, monté et réalisé par Jules Krot.
Crédits : Times News
Musique et habillage : Emmanuel Herschon / Studio Torrent
Logo : Jérémy Cambour
Comment écouter un podcast ? Suivez le guide.
Pour aller plus loin
Face à Donald Trump, l'Europe doit avoir l’envie d’être unie, par Eric Chol
Plan de paix de Donald Trump : comment la Maison-Blanche trahit l’Ukraine
Choyée par Donald Trump, la Russie de Vladimir Poutine n'est forte que de la faiblesse européenne

© afp.com/Fabrice COFFRINI

Avec la révélation du plan en 28 points concocté par Washington et Moscou pour mettre fin à la guerre, revient sur la table l’épineuse question de l’organisation d’élections en Ukraine. Vieille antienne de Donald Trump, qui, un mois après sa prise de fonction, avait traité le président ukrainien de "dictateur sans élection", cette clause, également réclamée par le Kremlin, soucieux d’éjecter Volodymyr Zelensky du pouvoir, prévoit ainsi l’organisation d’élections "dans 100 jours". Un délai très court, remplacé dans la contre-proposition européenne par la formulation plus vague "dès que possible". Initialement prévue en avril 2024, la dernière présidentielle a été ajournée depuis lors en raison de la loi martiale. Problème, dans un pays où près d’un million de personnes sont toujours mobilisées sous les drapeaux et 7 autres millions ont fui à l’étranger, cet appel aux urnes relève du casse-tête. Est-ce pour autant impossible ? "Il faut tout reprendre à zéro, juge Olha Aivazovska, présidente du conseil d'administration de l'ONG Opora, une organisation de référence chargée de la surveillance des élections et du processus électoral en Ukraine. La législation actuelle n’est plus adaptée pour conduire ces élections à court terme, car la guerre a modifié en profondeur les conditions d’exercice du vote." Entretien.
L’Express : Le plan en 28 points dévoilé la semaine dernière prévoit la tenue d'élections dans les 100 jours suivant la signature potentielle d'un accord de cessez-le-feu. Est-ce réellement possible en si peu de temps ?
Olha Aivazovska : Pas du tout. Malheureusement, l'Ukraine n'a pas eu la possibilité d’organiser d’élection depuis le début de l’invasion russe, et nos capacités à y parvenir sont plus réduites que par le passé. Cela s’explique par les très nombreux défis que représenterait l’organisation d’un scrutin dans le contexte actuel. Tout d’abord, il nous faut mettre en place une législation électorale spécifique, qui permettra de garantir la sécurité du vote dans ses multiples composantes. Actuellement, par exemple, près de 30 % du territoire ukrainien est miné, ce qui rend la logistique extrêmement problématique, ne serait-ce que pour l'acheminement des bulletins de vote et du matériel pour le jour du scrutin. Cette même législation devra par ailleurs mettre en place les instruments permettant de déterminer là où le processus électoral est possible, car de nombreuses communes ont été partiellement ou totalement détruites.
C’est particulièrement le cas pour les élections locales, car certaines zones ne comptent plus que 10 % d’électeurs, ce qui compromet la représentativité des instances qui seraient élues. En parallèle, de nombreuses infrastructures physiques, comme les bureaux de vote, ont été détruites pendant la guerre. Et nous manquons par ailleurs des ressources humaines pour s’occuper de l’organisation du scrutin. Il va donc être nécessaire de former de nombreux personnels, afin qu'ils acquièrent les compétences nécessaires et soient en mesure de faire face aux risques potentiels qui pourraient survenir. A l’heure actuelle, rien ne garantit que le processus électoral pourra se dérouler normalement si la Russie tente d'interférer dans les élections, à travers des attaques, ou de la désinformation. Le processus électoral sera donc très différent de ce qu’il pouvait être avant le début de la guerre, et nécessitera de facto des investissements supplémentaires.
Le système électoral doit donc être revu en profondeur…
Absolument. La protection physique des candidats, des bureaux de vote, la mise en place de protocoles de cybersécurité suffisamment développés pour les bases de données électorales d'État, nécessitent des moyens et du temps. Or, l'Ukraine n'a pas encore lancé le processus. Pour l’heure, personne ne sait à quelle élection fait précisément référence le plan de paix russo-américain. S’agit-il d’une élection présidentielle dans un délai de 100 jours ? Si c’est effectivement le cas, cela signifie que nous n’aurions que 10 jours pour organiser tout le processus électoral, dans la mesure où les campagnes présidentielles s’étalent habituellement sur 90 jours. C’est bien sûr impossible.
Encore une fois, il faut tout reprendre à zéro. Certaines circonscriptions qui étaient auparavant utilisées lors des législatives se trouvent par exemple aujourd’hui en territoire occupé. La législation actuelle n’est donc plus adaptée pour conduire ces élections à court terme, car la guerre a modifié en profondeur les conditions d’exercice du vote. Organiser des élections protégées et préparées de manière adéquate exigera des ressources considérables, dont l'État ukrainien est totalement dépourvu.
De combien de temps l'Ukraine aurait-elle besoin pour organiser des élections en cas d’arrêt des combats ?
Selon notre feuille de route, si la situation ne s’aggrave pas, ce serait impossible avant au moins six mois voire un an. On peut regarder les exemples du passé pour établir un point de comparaison. Après la guerre dans les Balkans, un délai de neuf mois avait été prévu avant de nouvelles élections. Pourtant, le pays n’était pas aussi vaste que l’Ukraine, et les infrastructures n’avaient pas subi autant de dégâts que les nôtres.
Les migrations engendrées par la guerre compliquent également la donne…
Effectivement, le registre électoral national n'a pas été mis à jour ces quatre dernières années. Il a été fermé après l'invasion à grande échelle, et les informations sur les électeurs ne sont plus valides compte tenu de l’ampleur des migrations aussi bien internes que dans d’autres pays. Or il est indispensable de prévoir suffisamment de temps pour que les personnes concernées puissent déposer une demande de changement d'adresse électorale. Et cela représente des millions de personnes. Actuellement, plus de 10 millions d'électeurs vivent hors des territoires contrôlés par le gouvernement ukrainien où ils sont inscrits. Cela représente plus de 30 % du corps électoral total. Pour mettre à jour le registre électoral national, une campagne de mobilisation et de sensibilisation est nécessaire, ainsi qu'un délai suffisant pour permettre à chaque électeur d’actualiser ses informations.
Justement, au moins 7 millions d'Ukrainiens ont fui à l'étranger depuis le début de l'invasion à grande échelle. Comment garantir leur droit de vote ?
C’est un enjeu primordial, car il serait extrêmement préjudiciable que les Ukrainiens résidant actuellement à l'étranger – soit plus de 20 % de la population ukrainienne – n'aient pas la possibilité de voter. En Pologne, par exemple, il n’y aurait actuellement que quatre bureaux de vote disponibles, alors que près d'un million d'Ukrainiens y vivent. Cela s’explique par le fait que, selon la législation actuelle, seules les ambassades ou les consulats peuvent participer au scrutin pour le vote à l’étranger. Il est donc important de faire en sorte qu’un nombre suffisant d’infrastructures situées en dehors des frontières ukrainiennes puissent offrir la possibilité de voter.
Dans le cas contraire, si 20 % de la population n'a pas la possibilité de voter physiquement, ces élections ne seront pas suffisamment inclusives pour être qualifiées de démocratiques, libres et équitables. L'Ukraine doit donc signer des accords bilatéraux avec chaque pays, comme la France, l’Allemagne, la Pologne, et tous les autres, disposés à soutenir ce processus et à installer davantage de bureaux de vote hors des ambassades. De plus, nous pourrions compléter ce dispositif avec un système de vote anticipé, pour permettre aux citoyens de se rendre aux bureaux de vote tout au long de la semaine. Ce type de méthode existe et est utilisé dans de nombreux pays, mais pas en Ukraine.
Près d’un million d’Ukrainiens servent actuellement au sein de l’armée. Est-il vraiment envisageable qu’ils puissent tous participer à un scrutin ?
C’est une autre difficulté, et il n’y a malheureusement pas de solution miracle. Cela dépendra de leur lieu de déploiement et de leurs missions au moment du vote. S'ils se trouvent près des lignes de front, il est peu probable qu'ils seront en mesure de voter - ce qui pose un problème de représentativité. Pour ceux qui seront un peu à l’arrière, on pourrait en revanche ouvrir des bureaux de vote spéciaux, ou leur accorder des créneaux horaires leur permettant de voter dans des bureaux civils classiques. L'exercice du droit de vote pour tous les groupes de population doit constituer un principe fondamental pour les premières élections d'après-guerre, car la légitimité des représentants élus dépendra de la qualité de la participation au scrutin.
L’autre enjeu, en ce qui concerne les citoyens qui servent actuellement sous les drapeaux, est de leur permettre de se présenter comme candidat s’ils le souhaitent - en particulier en ce qui concerne les élections législatives ou locales. Ce qui est actuellement impossible si vous êtes en service actif. Il faut en effet se rappeler qu’il y a cinq ans, 95 % des militaires actuels étaient des civils, et nous devons donc leur offrir une chance de participer. Un processus inclusif serait un outil efficace pour prévenir les conflits au sein de la société, car tous ceux qui investissent aujourd'hui leur vie et leurs ressources dans la sécurité et la défense du pays doivent avoir la possibilité de se faire entendre.
Quel serait le risque d'ingérence russe si des élections se tenaient en Ukraine après un cessez-le-feu ?
Le risque d'ingérence russe est de 100 %. La Russie a systématiquement instrumentalisé le processus politique en Ukraine, pour s'assurer la loyauté de certains groupes au pouvoir. On peut citer l’exemple de l’ancien député Viktor Medvedtchouk, qui a été l’une des grandes courroies de transmission de Poutine sur la scène politique ukrainienne. A la suite de l’invasion à grande échelle, la Russie investira encore plus de ressources pour tenter d’occuper politiquement l’Ukraine. De la même manière qu’elle le fait en Géorgie.
Moscou cherchera à polariser la société au maximum et à attiser les tensions entre différents groupes de la population. On peut donc s’attendre à tout un éventail d’actions contre l’infrastructure électorale, voire à des attaques directes contre certains candidats dans le but de saper la confiance dans le bon déroulement du processus électoral.
Concrètement, de quelle manière pourrait-elle s’y prendre ?
Les Russes sont passés maîtres dans l'art de la manipulation politique et nous en avons eu la preuve dans de nombreuses élections européennes récentes. En Moldavie, la Russie a par exemple utilisé la messagerie Telegram pour recruter des agents d’influence prêts à servir ses intérêts contre rémunération.
Au-delà de cette seule application, nous avons également vu en Roumanie comment elle avait utilisé l’ensemble des réseaux sociaux pour interférer dans les élections. Ces tentatives ont été stoppées de manière très difficile par la commission électorale roumaine. L'Ukraine doit donc tirer les leçons des dernières campagnes électorales dans les pays voisins et mettre en place un système de défense contre ces risques potentiels. La protection du processus électoral contre toute ingérence russe sera une question absolument cruciale.

© AFP

© MONIKA SKOLIMOWSKA / dpa Picture-Alliance via AFP

© GIORGI ARJEVANIDZE / AFP