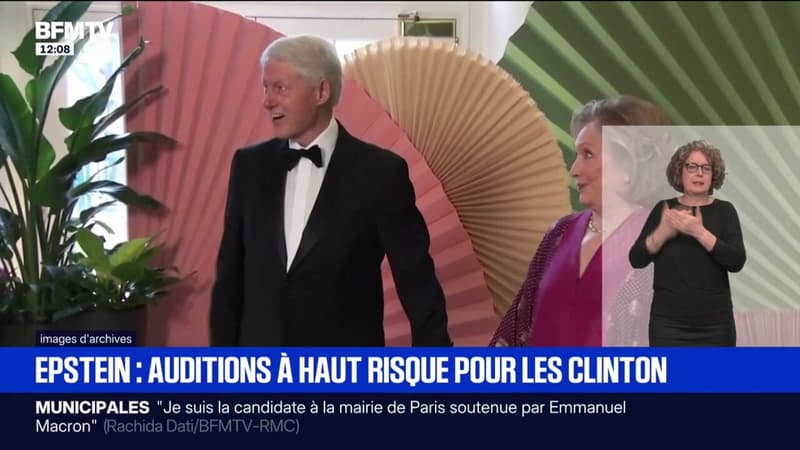« La trajectoire de Jeffrey Epstein rappelle que l’esbroufe et l’entourloupe restent monnaie courante »



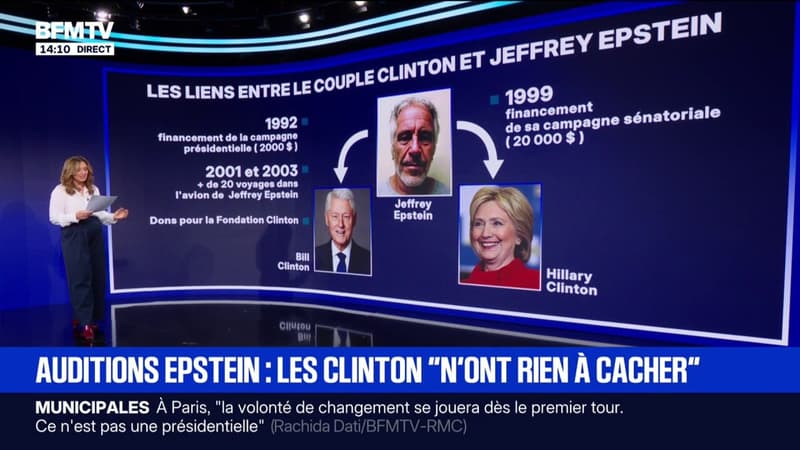

© STEPHANE DE SAKUTIN / AFP


© Thomas Padilla / via REUTERS
© Remo Casilli/REUTERS

© EBRAHIM HAMID/AFP


© SERGEY BOBOK/AFP

© « Le Monde »
Des affrontements sanglants... qui pourraient se poursuivre encore durant des mois ? Le spectre d'une guerre au long cours en Ukraine inquiète de nouveau l'Europe en cette fin février, quatre ans tout juste après le lancement de l'offensive de la Russie sur le territoire de son voisin, à l'hiver 2022. Cette hypothèse est appuyée par une vaste étude de l'Institut international d'études stratégiques (IISS), un des think tanks de référence au niveau mondial sur les questions de défense. Comme chaque année, le groupe de réflexion vient de publier ses perspectives en matière militaire pour l'année à venir. Avec un enseignement majeur : Moscou dispose de la capacité à maintenir sans trop de problèmes son attaque de l'Ukraine une année de plus.
Dimanche 22 février, le président russe, Vladimir Poutine, a ainsi fait part de son ambition de continuer à "renforcer l'armée et la marine" de son pays. Un objectif qui s'inscrit dans la poursuite de la politique menée ces dernières années : dans son analyse, l'IISS rappelle que les investissements de la Russie dans ses forces de défense ont déjà drastiquement augmenté depuis 2022. Rien qu'en 2025, ceux-ci ont encore crû de 3 %, après plusieurs années de hausse. Au total, ils ont représenté sur un an 186 milliards de dollars, soit environ 7,3 % du produit intérieur brut total du pays. Une proportion bien plus élevée que la part de la richesse nationale consacrée aux dépenses militaires par la France, la Chine ou les États-Unis.
La montée en puissance des moyens russes alloués à la défense est toutefois confrontée à un enjeu de taille : la perte de vitesse considérable, liée au conflit et aux sanctions internationales imposées à Moscou, de l'économie russe. Celle-ci n'a connu qu'environ 1 % de croissance en 2025 - un chiffre semblable à celui attendu pour cette année. De fait, les experts estiment que l'augmentation des dépenses de défense du pays risque de se tarir quelque peu en 2026. Mais cette projection n'est pas de nature à inquiéter outre mesure le Kremlin. Les investissements massifs dans les équipements et l'armement menés par la Russie depuis quatre ans lui donnent en effet une certaine marge de manœuvre pour poursuivre son offensive en Ukraine.
La guerre a poussé Vladimir Poutine à engager ou finaliser le développement de nombreuses armes, comme de nouveaux missiles, souvent présentés à grands coups de propagande par les médias d'État russes. Le complexe industrialo-militaire du pays a par ailleurs été mobilisé pour créer une nouvelle version du drone Shahed iranien, produit directement depuis son sol. Le soutien de Téhéran a été essentiel dans l'avènement de ce projet. L'ensemble de ces paramètres fait donc dire à Bastian Giegerich, directeur général de l'IISS cité par le Guardian, que "peu d'indications" montrent aujourd'hui que "la capacité de la Russie à poursuivre sa guerre contre l'Ukraine pour une cinquième année soit diminuée".
Pour autant, plusieurs aspects ont malgré tout de quoi préoccuper Vladimir Poutine. L'économie qui tourne au ralenti en est donc un. Taux d'intérêt très élevés, inflation généralisée, difficultés d'investissements pour les entreprises, manque de main-d'œuvre... La guerre en Ukraine a considérablement affaibli Moscou sur ce plan, avec des conséquences encore difficiles à anticiper à long terme. Mais le principal danger pour la Russie actuellement réside dans ses difficultés de recrutement pour soutenir ses combats sur le champ de bataille. Chaque mois, l'armée a besoin d'enrôler environ 30 000 nouveaux hommes afin de poursuivre son offensive. Or, il existe "des signes de plus en plus nombreux indiquant que le taux de recrutement de la Russie commence à être inférieur à ses pertes mensuelles", pointe Nigel Gould Davies, un autre expert de l'IISS, toujours auprès du Guardian.
Le Kremlin ne communique pas précisément sur les pertes humaines subies par son armée. Un récent décompte du média russe indépendant Mediazona et de la BBC Russia a confirmé la mort de plus de 200 000 soldats russes depuis 2022. Un chiffre qui pourrait être largement sous-estimé, selon les sources. Toujours est-il que Moscou a donc de plus en plus de mal à trouver de nouveaux volontaires pour combattre. Des détenus, parfois considérés comme très dangereux, sont envoyés sur le champ de bataille. L'armée recrute aussi des malades atteints de graves pathologies psychiatriques, ou des hommes souffrant d'alcoolisme ou de toxicomanie. Des profils qui ne sont pas toujours à même de constituer de véritables atouts pour l'armée russe, mais qui sont là pour faire le nombre une fois sur le front.
Pour pousser de nouveaux hommes à s'engager, la Russie promet aussi le versement d'importantes primes financières. "Le plus grand danger de ce modèle de recrutement de volontaires réside probablement dans l'impression que cela n'en vaut tout simplement pas la peine, car on va mourir et la guerre ne finira jamais", relève Janis Kluge, chercheur à l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité (SWP), dans un entretien accordé à Mediazona. "Et cela peut arriver de façon soudaine et inattendue si l'idée que c'est trop dangereux se répand parmi la population masculine russe." Pour le moment, aucune mobilisation générale n'est envisagée par Vladimir Poutine. La précédente mobilisation partielle, à la fin de l'été 2022, avait suscité une vague de contestation, avec des manifestations dans plusieurs villes russes.
© via REUTERS



© Brian Inganga / AP

© DENIS BALIBOUSE/REUTERS/« Le Monde »