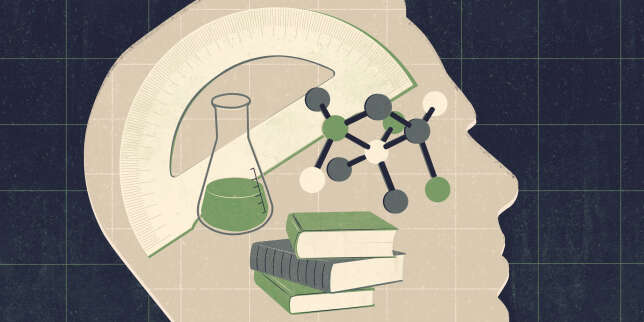Voici la meilleure place dans l’avion pour limiter les turbulences au maximum
Les turbulences en avion sont une source d’angoisse pour de nombreux passagers. Pourtant, il existe des astuces simples pour les atténuer dès la réservation du billet : tout dépend de la place que vous choisirez à bord. Alors, où s’asseoir pour un vol le plus paisible possible ?