Vers une action militaire américaine en Iran ? La Maison Blanche indique que la décision de Donald Trump n'a pas encore été prise


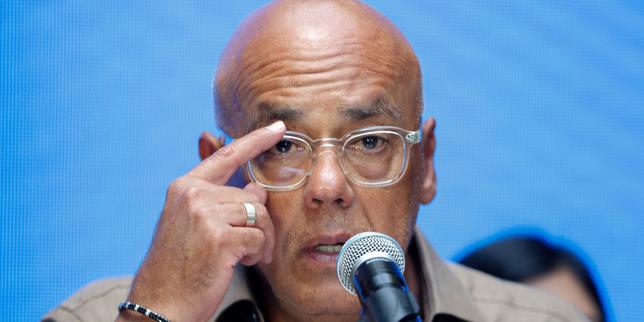
© PEDRO MATTEY / AFP


© Ohad Zwigenberg / AP


© Damian Dovarganes / AP

© VIRGINIE NGUYEN HOANG/HL/HUMA POUR «LE MONDE»

© - / AFP





Donald Trump a annoncé samedi sur son réseau Truth Social l'augmentation de sa nouvelle surtaxe mondiale de 10 % à 15 %, après que la Cour suprême des Etats-Unis a annulé la veille les droits de douane dits "réciproques" qu'il avait imposés en 2025, dont une partie a été jugée illégale.
"Sur la base d’un examen approfondi, détaillé et complet de la décision ridicule, mal rédigée et extrêmement anti-américaine sur les droits de douane rendue hier, après de nombreux mois de réflexion, par la Cour suprême des États-Unis, veuillez considérer cette déclaration comme l’expression de ma volonté, en tant que président des États-Unis d’Amérique, d’augmenter immédiatement les droits de douane mondiaux de 10 % sur les pays, dont beaucoup ont “exploité” les États-Unis pendant des décennies, sans représailles (jusqu’à mon arrivée !), au niveau pleinement autorisé et légalement testé de 15 %", a-t-il écrit sur son réseau social.
La veille, furieux de la décision de la plus haute juridiction américaine, Donald Trump avait ordonné une surtaxe mondiale de 10 % sur tous les produits importés, supposée entrer en vigueur le 24 février pour une durée de 150 jours, avec quelques exemptions sectorielles.
La loi l'autorise à imposer des droits de douane pouvant aller jusqu'à 15 % sur une période de 150 jours, même si cette décision peut faire l'objet de contestations judiciaires.
© REUTERS
L'heure est-elle aux élections anticipées au Danemark ? Sortie renforcée politiquement de son bras de fer avec Donald Trump, au sujet de l'île danoise du Groenland, la Première ministre Mette Frederiksen veut tout faire pour capitaliser sur cet élan. Au point, selon le média Bloomberg, d'avancer les élections prévues initialement le 31 octobre prochain, au moment qu'elle jugerait le plus opportun.
Avant le regain de tensions avec les Etats-Unis, en janvier dernier, la sociale-démocrate se trouvait pourtant fragilisée sur le plan national. La hausse du coût de la vie, ainsi que la suppression d'un jour férié ont en effet suscité un vif mécontentement de la part de l'opinion publique danoise. Symptôme du recul des sociaux-démocrates, le parti avait subi un revers l'année dernière lors des municipales, allant jusqu'à perdre son bastion historique : la capitale, Copenhague. Une première en un siècle.
Mais les tensions internationales semblent avoir dévié l'attention, et fait émerger Mette Frederiksen, 48 ans, comme la leader qui tient tête à une puissance américaine imprévisible, avec le soutien de l'Europe. Depuis, les sociaux-démocrates danois ont progressé dans les sondages, passant de 18 % en décembre à 23 % en janvier.
"La question du Groenland n'étant toujours pas résolue de manière définitive, les électeurs souhaitent élire la personne la plus à même de diriger le Danemark dans un environnement mondial plus hostile", analyse Bloomberg, qui estime que la sociale-démocrate, née dans un milieu ouvrier et engagée en politique dès l'adolescence, a de bons arguments. Devenue députée à l'âge de 23 ans seulement, en 2001, elle est considérée depuis ses débuts en politique comme une personnalité au franc-parler, parfois qualifiée de "Margaret Thatcher de gauche".
En ce sens, la déclaration commune publiée avec d'autres dirigeants européens exhortant Donald Trump à respecter les frontières du Groenland a été considérée au Danemark comme une victoire diplomatique importante. Début janvier, le président américain avait en effet déclaré qu'il s'emparerait du Groenland, territoire danois autonome de l'Arctique. Une menace d'autant plus inquiétante qu'elle intervenait juste après la capture par les Américains du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro.
Mette Frederiksen n'est cependant pas la seule à bénéficier de la conjoncture internationale. Au Canada, en Australie ou encore au Brésil, beaucoup de dirigeants ont fait de la défense de la démocratie et des valeurs libérales contre Donald Trump un atout électoral. La cheffe du gouvernement avait d'ailleurs connu un scénario similaire, au moment de la gestion de la crise du Covid-19.
Malgré ce regain de popularité, les sociaux-démocrates, qui détiennent actuellement 50 sièges sur 179, passeraient tout de même à 41 députés, selon les derniers sondages. Ils devraient se maintenir comme première force parlementaire, mais n'auront d'autre choix que de chercher des alliances avec d'autres partis. Actuellement, ils dirigent le pays en coalition avec le centre-droit.
"Si des élections avaient lieu aujourd'hui, la coalition devrait remporter 73 sièges. Il leur manquerait tout de même 17 sièges pour atteindre les 90 nécessaires à la majorité, ce qui les obligerait à négocier avec d'autres partis. Mais c'est loin de ce qui, il y a quelques mois à peine, ressemblait à une déroute imminente", explique Politico. La question est désormais de savoir si Mette Frederiksen ira jusqu'à convoquer des élections anticipées pour profiter de la séquence politique. Elle l'avait déjà fait en 2022, en organisant un scrutin éclair alors que sa popularité était en baisse, conservant ainsi le pouvoir.
Malgré tout, "ce type de soutien est éphémère", rappelle auprès de Bloomberg Kasper Moller Hansen, professeur de sciences politiques à l'université de Copenhague. "Si les électeurs défendent leur nation dans les moments difficiles, ce n'est pas pour autant que les Danois sont soudainement devenus des sociaux-démocrates". En quelques années, la cote de popularité de la dirigeante a considérablement reculé, passant de 79 % en 2020 à 34 %, relève POLITICO.
© via REUTERS
