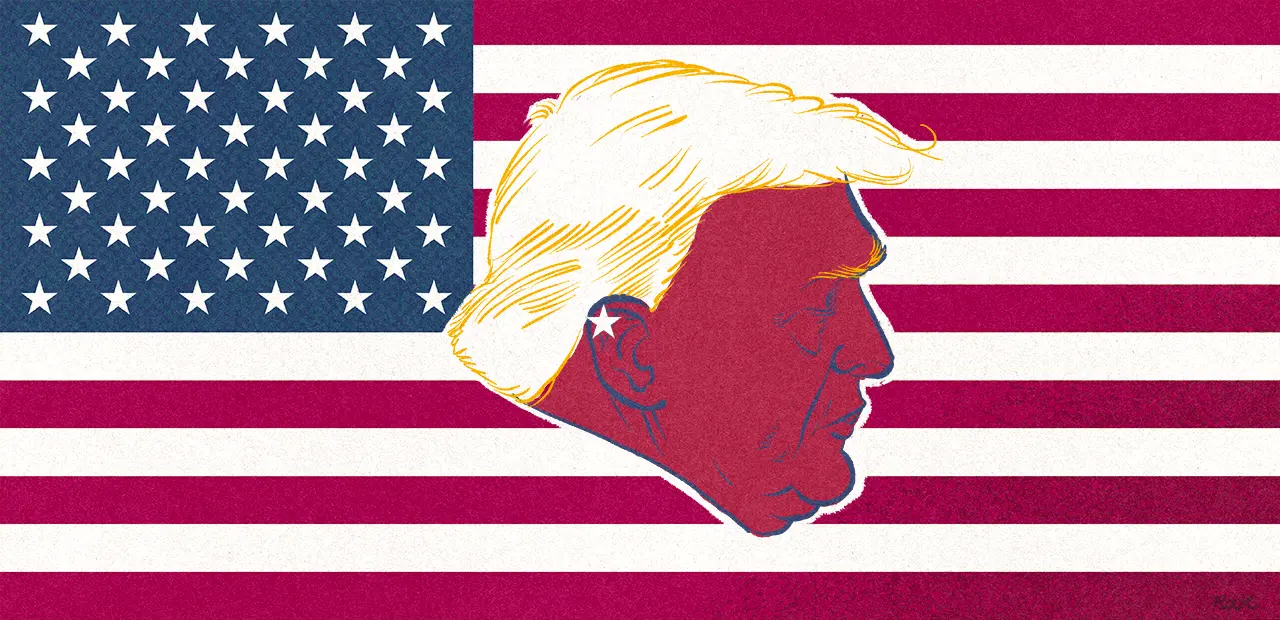L’impact de l’IA sur la planète ? Personne n’en parle (mais l’IA sert la désinformation)
Next, si !

Si des études scientifiques s’y attellent, les effets de l’explosion du secteur de l’intelligence artificielle sur l’environnement restent très peu discutés dans l’espace public, selon un rapport de Sopra Steria.
Depuis l’été 2022, l’intelligence artificielle est dans toutes les discussions. Impacts économiques, politiques, médiatiques, potentielle bulle financière, même, tous ses effets sont décortiqués à l’exception d’un, et non des moindres : celui que le secteur a sur l’environnement.
Entre janvier 2024 et avril 2025, moins de 1 % des 802 465 publications X et LinkedIn liées à l’IA et analysées par Opsci.ai évoquaient par exemple les effets de l’intelligence artificielle sur l’écosystème planétaire. Menée avec Opsci.ai, une récente étude de Sopra Steria sur le brouillard informationnel qui obscurcit les liens entre IA et environnement constate que le climat n’arrive qu’en huitième position des préoccupations des 100 leaders de l’IA listés par le Time Magazine, loin derrière les débats autour des modèles ou encore de l’actualité du secteur.
Le sujet est pourtant d’importance : si le rôle de l’humanité dans le réchauffement climatique fait consensus dans la communauté scientifique depuis plus de 15 ans, 33 % de la population française considère en 2024 que le réchauffement climatique n’est qu’une hypothèse sur laquelle les scientifiques ne sont pas tous d’accord. Et alors qu’une soixantaine de scientifiques du GIEC annonçaient mi-juin que le maintien du réchauffement climatique sous les 1,5 °C de plus qu’avant l’ère pré-industrielle était désormais impossible, 29 % de la population mondiale doute de ce consensus.
Sur le rôle spécifique de l’IA dans le domaine, les calculs sont complexes, mais les premières données scientifiques sont claires : recourir à des modèles de langage généralistes est beaucoup plus consommateur que de se tourner vers de plus petits modèles – des besoins en énergie qui, le plus souvent, sont synonymes d’accroissement significatif de multiples impacts environnementaux, à commencer par les émissions carbone.
Relative focalisation sur la question énergétique
Du côté des personnes clairement intéressées par la lutte contre les bouleversements climatiques, l’IA n’occupe que 2,85 % des discussions, constate Sopra Steria après analyse de 314 419 messages issus d’un panel LinkedIn dédié. Dans ces cas là, elle est principalement présentée comme une menace en termes d’énergie – un enjeu compréhensible, dans la mesure où le patron d’OpenAI lui-même suggère qu’à terme, « une fraction significative de l’énergie sur Terre devrait être consacrée à l’exécution de calculs d’IA ».
Quasiment pas de trace, en revanche, de ses effets sur le cycle de l’eau, sur lesquels le sociologue Clément Marquet ou l’urbaniste Cécile Diguet sont revenus pour Next, ou sur la santé des populations, pourtant directement touchée par la pollution atmosphérique des centres de données.
En s’arrêtant sur l’épisode de génération mondiale de starter packs, qui avait ouvert un semblant de discussion sur le sujet, l’étude constate que les discours sur X et sur LinkedIn sont relativement différents.
Sur la première plateforme – dont le manque de modération a par ailleurs fait fuir bon nombre de spécialistes depuis plusieurs années, l’essentiel des discussions était enthousiaste envers le fait de se créer des starter packs, et consistaient à partager des conseils de prompts (requêtes). 17,2 % des publications émettaient néanmoins des critiques, dont 2,4 % en s’inquiétant spécifiquement de l’eau utilisée par les data centers.
Sur LinkedIn, 29,4 % des publications critiquaient les starter packs. Les publications enthousiastes restaient majoritaires, souligne l’étude, mais ont recueilli moins d’engagement (22,86 % du total étudié) que celles critiquant le fait de générer ces images (33,56 %).
L’IA au service de la désinformation
Impact indirect de l’IA : les modèles génératifs servent par ailleurs à désinformer sur les enjeux environnementaux. En 2024, l’IA avait notamment été employée dans la campagne de désinformation qui avait perturbé le secours aux victimes des ouragans Hélène et Milton. En janvier 2025, l’European Digital Media Observatory alertait sur le fait que ces thématiques étaient devenues le premier sujet de désinformation en Europe.
Sur X, le chatbot Grok de xAI participe par ailleurs directement au problème, glissant directement des propos climatosceptiques dans certaines réponses relatives au climat – le robot a par ailleurs été utilisé pour produire une « étude » dont la totalité du propos vise à nier le rôle de l’humanité dans le changement climatique.
Les médias traditionnels ont, eux aussi, des progrès à faire. En recourant à de la détection automatisée (d’aucuns la qualifieraient d’IA), QuotaClimat a détecté pas moins de 128 cas de désinformation environnementale dans l’audiovisuel français en 3 mois, soit une dizaine de propos faux par semaine.